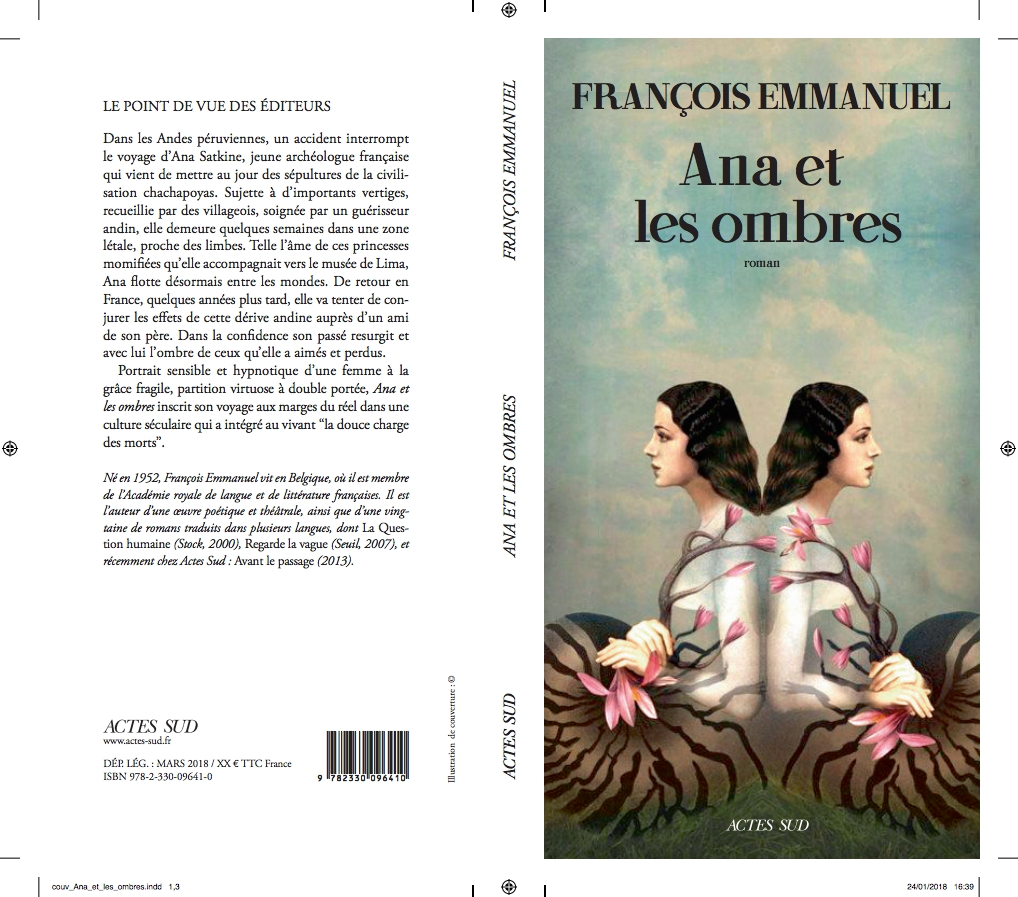
Editions Actes Sud, mars 2018
« Quatre jours après son arrivée à Llandacasi, Jairo était descendu la chercher pour lui donner la primeur de la plus haute des chambres funéraires, celle qui n’avait pas été visitée par les pilleurs de tombes. Tôt ce matin-là, les campesinos avaient profité du temps sec pour consolider l’accès à la chambre puis ils avaient reçu l’ordre de tout arrêter. Lire la suite
Depuis le haut de la falaise l’un d’eux avait poussé des cris de singe hurleur pendant que Jairo redescendait jusqu’au camp pour parlementer avec Menendez. Il régnait sous la grande tente une atmosphère de conspiration, les deux étudiants qui travaillaient aux empaquetages s’étaient interrompus et Vera la jeune anthropologue avait aussitôt refermé son ordinateur portable, fourrant son carnet de notes dans sa parka et trifouillant sous la table à la recherche de ses objectifs. De loin Menendez s’était tourné vers elle et lui avait lancé joyeusement : Vamos a ir ! Il devait être midi, le ciel était parfaitement bleu et son cœur s’affolait déjà lorsqu’elle grimpait barreau après barreau l’échalier aux montants brêlagés rejoignant le sentier de chèvres qui sinuait abruptement sur le versant pierreux de la falaise puis aboutissait au petit belvédère juste avant la plateforme en planches. Elle s’avance sur la plateforme entre Vera et Jairo, elle traverse le rideau de pluie fine, elle est sur le terre-plein boueux, les creuseurs se sont écartés, ils la regardent et ils attendent. Une grande échelle métallique est appuyée en hauteur sur le nid d’aigle, madriers et branchages, qui permet l’accès à la chullpa du haut, la tombe inviolée. Au-dessus de celle-ci on distingue mieux à présent la frise en pierres imbriquées, au motif géométrique de serpent, tachées çà et là d’ocre rouge. Le chef des campesinos l’attend au pied de l’échelle et Jairo lui souffle : Ahora es el momento. À la verticale de la falaise le soleil de midi irise à gauche la petite chute de pluie fine mais excepté ce léger bruit d’eau il règne un curieux silence, parce qu’en bas le groupe électrogène s’est tu, et surtout parce que les hommes ne parlent pas, ils désapprouvent peut-être, ils n’aiment pas cette prééminence accordée à la gringa. Les échelons métalliques couinent, en haut les quelques pierres équarries qui muraient l’entrée de la chambre ont été déposées dans leur agencement d’origine sur le petit promontoire du seuil, à côté du nid d’aigle, mais la rangée du bas est restée en place et l’on peut déjà deviner à l’intérieur une jonchée de vases et d’offrandes parmi des fagots secs sous une très légère vapeur de poussière. Il faut lutter contre la clarté blanche, ce soleil cloué au zénith, faire visière d’une main, puis plonger avec la lampe frontale dans la cavité afin d’accommoder lentement à deux formes rotondes, adossées au mur du fond et comme penchées l’une vers l’autre pour se soutenir. Ce sont de grandes poupées tranquilles, leurs visages brodés, effarés, impassibles, cette présence émergée de l’ombre qu’elle reconnaît des clichés de la Laguna de los Condores mais qu’elle découvre soudain avec une sensation de puissante irréalité, me parlant d’un silence effroyable, l’impression, me dirait-elle, d’un monde fermé, scellé, de grisaille et de stupeur, un monde au-delà du monde, et elle ajouterait que je ne pouvais pas comprendre, personne ne pouvait comprendre la terrifiante présence de ces deux muñecas, endormies, enfantines et comme à jamais spectrales.
Sur la paroi voûtée de la chambre il y avait un dessin en ocre rouge fondu à la matière de la roche et qui serait précisé plus tard grâce aux clichés en lumière filtrée : petit être anthropomorphe bras au ciel, jambes écartées, sexe agrandi, triangulaire, créature de la naissance et de la mort, la même peut-être qu’à Gran Pajatén, mais ici plaquée en ocre, non loin d’un félin, d’un singe, d’un mille-pattes sacré, tous réduits à quelques traits grossiers, sauvages, esquissés du plat du pouce et dansant sur le haut de la voûte pour achever de composer une arche de symboles et au même titre que les vases sacrés, les oblations, le tapis de branches séchées, embaumer le voyage dans le temps.
Et plus tard, alors que le soleil avait basculé derrière la falaise et qu’on acheminait d’en bas les batteries électriques chargées, que le technicien, les étudiants archéologues, investissaient l’étroit promontoire avec les projecteurs lumineux, dans cette agitation fiévreuse où les campesinos semblaient soudain désœuvrés et perdus, elle s’était sentie vidée de toute énergie, incapable de rester là comme de redescendre, se postant à l’extrême bord du terre-plein et s’accroupissant au pied d’un tronc en fixant la vallée. Sentant Jairo qui venait sans bruit dans son dos et s’entendant lui dire pourquoi faisons-nous ce métier ? Et lui qui pendant longtemps n’avait pu trouver à répondre, puis avait marmonné quelques mots à propos des huaqueros, des paquets funéraires fracassés à la hache dans les deux chullpas du bas, expliquant ce qu’on expliquait toujours, ce qui autorisait toutes les entreprises, qu’au vol furieux des pilleurs de tombes il valait mieux préférer le vol précautionneux des archéologues.
Puis au soir, on avait descendu en civière les deux momies protégées par de grandes feuilles de plastique noir, on les avait entreposées de l’autre côté de la cloison de toile qui scindait en deux la tente de Menendez, cet endroit qu’on appelait la reserva et où attendaient rangés pour l’empaquetage les autres paquets funéraires. Certains avaient été éventrés au couteau ou à la machette, laissant entrevoir des crânes dont les mains momifiées étaient plaquées sur les orbites, comme dans une attitude de protection, leurs phalanges reliées entre elles par de petites cordes annelées. Et parfois un membre affleurait, une saillie osseuse, humérus, fémur, ou un vestige parcheminé de bras ou de jambe, entaillé par la lame des pilleurs. Mais les deux fardeaux funéraires de la chullpa du haut auraient droit à eux seuls à tout un rayonnage de la reserva, aux égards que l’on voue aux dignitaires de haut rang, parce que leur tissu était précieux, gris-bleu, teinté d’un motif de serpent et complété par une bande tissée sépia qui encadrait les lignes brodées des visages, sous la tresse emmêlée de corde et de cheveux, jaillie du sommet du crâne, à tel point qu’on leur donnerait le genre féminin, qu’on les appellerait princesses, princesas, qu’on en ferait des sœurs, des jumelles, mortes en même temps, ou réunies dans la mort par ce même fourreau textile. De même elle, la Francesa, hériterait chez les campesinos de ce petit nom aristocratique, parce qu’elle avait eu la primeur de la chullpa du haut et pour moquer sa coquetterie, ses allures distantes et raffinées.
Cette princesse, je l’imagine, qui cachait son regard derrière des lunettes fumées, dormait sur un lit de camp dans la tente des filles, ne se mêlait pas aux tâches de déblai, vaisselle, empaquetage, lavait ses cheveux tous les trois jours, ne buvait que de l’eau bouillie, cette princesse en bottines de cuir, pantalon de lin et foulard de soie, qui ne comprenait rien à l’espagnol bougonné, guttural, des gens de Lima, encore moins au sabir moqueur mêlé de quechua que grommelaient entre eux les campesinos, cette fille de France qui mangeait à table avec lenteur, serrait contre elle un éternel carnet noir, dispensait dans le groupe un sourire rare, lointain, un regard d’effroi timide, cette beauté solitaire et toujours un peu égarée, aux manières délicates, qui craignait de se salir les mains, cette seule étrangère parmi les trois femmes du camp – Vera l’anthropologue et Varvara, l’étudiante archéologue – et dont l’expression timorée, un peu hautaine faisait marmonner entre eux les hommes : la princesa.
Et Jairo qui un soir à table les avait corrigés à voix forte : Ana – qu’il prononçait Anna, en allon- geant le n, comme une caresse de la nasale. Jairo qui retraduisait pour elle le moindre mot d’esprit, se faisait en toute occasion son acolyte, chevalier, ange protecteur, au point que ses prévenances faisaient sourire dans les tentes, et persifler Menendez : tu pequeña protegida.
Ils sont seuls le dernier soir dans le local vide de la communauté paysanne de Chiliquín. Ils ont chevauché toute la journée, resanglé quinze fois le cheval noir pour rééquilibrer sur ses flancs les deux fardeaux funéraires. Ils ont connu la liberté folle d’être seuls au monde. Le vaste, l’immense paysage les a traversés l’un et l’autre, les splendides nuages du ciel. Tout au long des quarante kilomètres qui séparent Llandacasi du village ils n’ont rencontré qu’une vachère sur le sentier descendant et qui houssinait sa bête en riant de toutes ses dents. Les gens de Chiliquín les ont pris pour mari et femme, ou compañeros, ils leur ont ouvert le grand local des réunions avec des amoncellements de chaises en plastique et un vieux lit double repoussé contre un mur. C’est leur unique nuit avant que tout les sépare, elle sent son cœur qui cogne, se peut-il que ce soit cela l’amour dont parlent les livres, se peut-il que l’amour l’ait enfin gagnée, cette folle floraison des sens dont elle s’était crue pour toujours interdite, se peut-il que le calice de ce dangereux bonheur lui soit enfin tendu. Et je la vois dans la clarté mouvante de la bougie face au grand homme intimidé qui n’ose pas plus qu’elle se déshabiller, pour faire diversion se promène comme insouciamment dans la pièce et commente les trois cartes du village, punaisées contre le mur du fond avec des petits chevaux, des toucans naïfs, qui dansent dans le faisceau de sa torche, et ce camino de herradura, qu’il lit d’une voix suspendue, réverbérée dans la salle vide. La pluie, qui tout le jour s’était tenue à distance, commence à marteler par petits grains le toit de tôle ondulée, très vite resserre son cou- vrant, c’est un grondement sourd qui désormais les environne. Ils sont séparés par le grand lit aux cou- vertures amoncelées et elle n’ose lui dire qu’elle a froid, car tous les mots sont hantés, obérés, par les mots du désir des corps, leur irrésistible attirance. Puis c’est lui qui paraît rompre : il s’assied sur le lit et fait mine de fouiller dans son sac de voyage, puis d’un coup, dos à elle, répète son prénom d’une voix sourde, son poing serré sur la sangle du sac, interrogeant soudain : pourquoi, pourquoi, pourquoi toi, Ana, ajoutant qu’il se sent misérable d’avoir toujours envie de la regarder, misérable et lourd auprès de sa beauté, ces mots qui profondément la troublent, parce qu’elle les avait imaginés tout autres, alors que prononcés ainsi exactement, de sa voix grave et noyée par le souffle, ils lui donnent à éprouver un chancellement qu’aucun homme n’a jamais pu lui offrir. Et je tente encore de les voir dans le local des campesinos de Chiliquín, je crois voir comme son corps d’homme est grand et maladroit, je vois le moment où il vient vers elle, et comme elle se laisse entourer par ses bras, dans la découverte ahurie, l’assentiment radieux à son visage. Je comprends ou je crois comprendre ce dont elle me parlera plus tard, à l’évocation d’ailleurs d’autre chose, ce sentiment de perdre pied, faillir, tomber, son corps sombrer dans des eaux de plus en plus claires, un ciel qui peu à peu se déchire. Et ils sont étendus maintenant l’un à côté de l’autre, ils ont fini de s’aimer, il est couché à côté d’elle et sa respiration ralentit au rythme de la sienne cependant que l’arche couvrante de l’averse s’est éloignée, que l’on n’entend plus que quelques gouttes éparses, un dégoulinement de gouttière, ils sont étendus sur le lit double à ne plus oser se toucher, et voici que les belles histoires sont tombées, sa voix s’enroue puis s’assèche, il respire fort, elle avance une main vers son visage et voit qu’il serre les yeux, grand homme, pour ne pas pleurer, se sent tout entière parcourue par cette même lézarde, et dans ce pressenti de la fin des choses elle revient vers lui front contre front, lèvres contre lèvres, pour de nouveau chercher le passage, le lumineux passage, ce grand tronc vide du divin où s’enlacent leurs corps mortels.
P.47-54