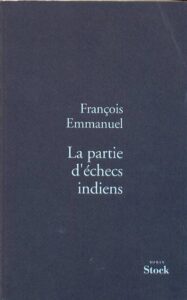



Édition: Éditions de la Différence, 1994.
Réédition: Stock, 1999 et Labor, Collection Espace Nord, N°195
Lecture de Laurent Demoulin.
Prix des amis des bibliothèques, Bruxelles 1995 et Prix Charles Plisnier 1995.
Traduction:
Traduit en slovène par Suzana Koncut, éditions Modrijan, Lubliana.
Tamil Nadu, Salem. L’express s’y est arrêté vers sept heures du matin et nous avons attendu deux heures jusqu’à ce que la chaleur devînt intenable à l’intérieur du compartiment. Sur les quais grouillait la foule des mendiants, camelots, porteurs, rabatteurs, vendeurs de beignets, de beedees, de gâteaux secs, serveurs de café agitant leur crécelle : coffee, coffee… Lire la suite
chaque fois qu’un nouveau train martelait le sol de la gare en répandant une épaisse fumée. Une femme aux prunelles en feu, un bébé enroulé sur son sein, me suivait partout, de comptoir en waiting room, implorant : rupee, rupee, sir.. Je m’étais réfugié au bout du quai, auprès de ballots de coton, là où un auvent projetait une lumière bleu sale sur la route en contrebas. Le flux y était permanent. Des piétons s’insinuaient dans la poussière entre les taxis, les rickshaws, les chariots peinturlurés, les camions couronnés de déesses, un autobus sans vitres, un tombereau d’agrumes, une vache, un cochon noir, une Ambassador rutilant dans le premier soleil, un cycliste équilibrant sur sa tête d’immenses mannes d’osier… C’était l’Inde, au travers ici de la lumière filtrée, c’était la première fois que je la regardais vraiment. J’avais passé les jours précédents à me protéger d’elle, me murant dans mes images, fermant mes sens aux cris, aux supplications, au vacarme, à l’odeur entêtante de putréfaction. A présent le regard que j’arrivais à poser sur elle était plus fort que la nausée. Il suffisait de supporter pour voir, et voir pour que l’envoûtement commence : tout renaissant de tout, les fleurs, les animaux, les dieux et les hommes emportés dans le même fleuve indistinct, fécond et putride. Sur les ballots de coton, à côté de la mendiante, une femme s’était assise avec un sari bleu sombre, ourlé d’or, elle avait du jasmin dans les cheveux, des bracelets d’argent qui tintaient aux chevilles et une façon veloutée, lointaine, de laisser l’étranger poser sur elle son regard.
En raison d’un déraillement sur la ligne entre Erode et Tiruppur, il me fallait soit prendre le bus vers Coimbatore, soit demeurer un jour et sans certitude dans la fournaise de Salem. J’ai choisi de ne pas attendre. Sur la route encombrée le bus roulait à toute allure sans cesser de corner. Vers midi il s’est arrêté sur un terre-plein planté d’une antique pompe à essence et d’une sorte de hangar en torchis. La plupart des voyageurs y sont descendus. A l’intérieur on servait à pleines louches du riz sur des feuilles de bananier. Un homme passait entre les tables avec des gamelles de sauce accrochées à son ceinturon. L’eau de boisson était tiède, les odeurs grasses et les nappes de plastique collantes. C’est en rentrant dans le bus que je me suis aperçu du vol de ma valise. J’en ai fait part au chauffeur du bus qui a répandu la nouvelle en poussant de hauts cris. Les gens se sont concertés, un petit homme en dhotî blanc a exigé que l’on sorte tous les bagages de la soute où pourtant j’étais sûr de n’avoir rien déposé. Il a fini par s’excuser pour ces concitoyens, j’ai reçu de partout des sourires navrés et de petites cigarettes. Enfin le bus est repart sans ma valise dans un nuage de poussière.
L’homme en dhotî blanc était stylographe, il avait pour métier d’écrire ce que les gens lui dictaient dans la rue, des lettres de menaces aux lettres d’amour, sans oublier les prières votives ou les fragments de textes sacrés. J’écrirai à mon arrivée une lettre de réclamation, promit-il avec un gentil sourire. Un peu plus tard le bus s’est immobilisé sur le bas-côté de la route et la chaleur est devenue intenable. Je tenais précieusement sur mes genoux la boîte noire avec le Guadagnini et j’essayais de me souvenir de ce qu’il y avait d’absolument nécessaire dans ma valise. Peut-être en effet bien peu de choses : des vêtements, un rasoir, quelques livres… Dans ce pays rien n’arrivait par hasard, à ce que l’on disait.
Le chauffeur du bus avait affalé la tête sur son volant et dormait.
A Coimbatore, comme dans tout le sud de l’Inde, la nuit tombe sans crépuscule. A peine laisse-t-elle le temps aux néons de s’allumer que l’on est plongé dans la ténèbre tropicale, avec des frelons énormes qui se cognent contre le verre des lampes. A sept heures du soir, sous le jus lumineux des enseignes, la rue bouillonne comme en plein jour. Mon ami stylographe s’appelait Sakharam, il m’a présenté à sa femme et à sa mère, deux ombres dans une embrasure, et m’a invité à partager son repas – des bananes naines, d’énormes crêpes craquantes – assis à même le ciment dans un appartement de deux pièces, non loin d’un cinéma dont les haut-parleurs éraillaient pour toute la rue la voix criarde de sa chanteuse. Sakharam voulait écrire sa lettre, il tenait aussi à me présenter à un homme qui, selon lui, avait des dons pour retrouver les choses. Je ne sais d’où lui venait cet acharnement, peut-être était-il factice. L’homme en question devait être une sorte de sadhu car nous l’avons trouvé torse nu, assis en lotus au pied d’une déesse garnie de fleurs fraîches. Il avait un oeil déformé par le trachome et paraissait ivre. Quand il a reçu l’explication de mon ami, il a souhaité prendre sur ses genoux ma boîte à violon. Il y a posé ses mains noueuses et s’est mis à incanter d’une voix nasillée quelque chose que mon ami n’a pas voulu me traduire. Il a fallu que j’insiste. C’est le texte d’une Upanishad, a-t-il dit, cela n’a rien à voir… – Quelle Upanishad ? Il a haussé les épaules : la Kaushîtaki. Puis il a repris l’instrument des mains du vieil homme et nous l’avons quitté dans un échange de mots un peu rêches. Je n’ai pas compris ce jour-là. C’est le lendemain que j’ai pris connaissance du texte de la Kaushîtaki Upanishad. A le relire j’en éprouve encore aujourd’hui une sorte de stupeur :
Quand le père est sur le point de mourir, il appelle son fils.
Il a jonché la maison d’herbes nouvelles, il a installé le feu.
Il a déposé à ses côtés une jarre d’eau avec une coupe, et il se couche, revêtu d’un costume neuf.
Le fils s’assied en face de lui.
– Je veux mettre en toi ma voix, dit le père.
– Je reçois en moi ta voix, dit le fils.
– Je veux mettre en toi mes souffles, ainsi le père.
– Je reçois en moi tes souffles, ainsi le fils.
P. 219-223