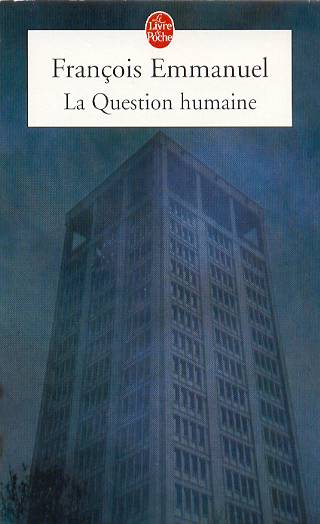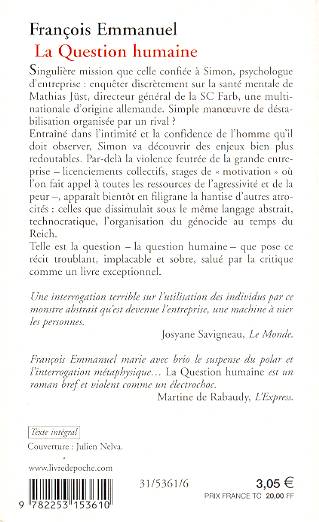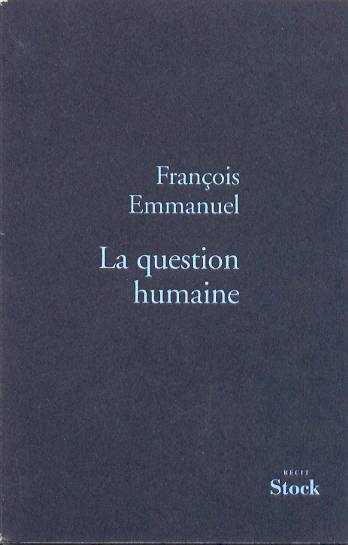Au sortir de cette lecture horrifiée il m’est apparu qu’il fallait faire connaître ce texte, lui donner une chambre de résonance fictionnelle, parce qu’il révélait une part de la mécanique génocidaire Nazie que l’on n’avait pas assez montrée. En cause ici : nulle violence, nul sadisme latent, mais la langue neutre, efficace des ingénieurs et des logisticiens. Qu’à l’époque une telle façon de voir (et surtout de ne pas voir) fût au service d’une idéologie folle et mortifère n’enlevait rien à cette sorte d’analogie qui s’imposait à moi, puissamment, au regard de ce que je sens sourdement à l’œuvre dans bien des secteurs de la société contemporaine, et plus particulièrement dans le monde de l’entreprise. Là aussi même dévoiement de la langue, litote ou réduction technique, même obsession de l’efficacité, même compartimentation de la pensée. Certes une analogie n’est rien d’autre qu’une analogie mais celle-ci demeure interpellante, comme si le contexte de guerre totale et de délire racial de ces années noires offrait soudain un verre grossissant, mettant en évidence une dérive rampante de la pensée occidentale depuis l’avènement de la science et la révolution industrielle : « Dans une époque sombre, l’œil commence à voir » (T. Roethke)
Mais tout ce que j’évoque ici, je n’en avais pas tout à fait la conscience lors de ma lecture terrifiée de la lettre du 5 juin 42. C’est bien des années plus tard que tentant de revenir aux sources de mon saisissement j’ai entrevu et conduit peu à peu ce récit fictionnel sec, clinique, au cœur duquel apparaît la terrible lettre. La genèse d’un livre de fiction est toujours tâtonnante. Au début j’avais la vision d’un chef d’entreprise interné dans un hôpital psychiatrique et dont le délire faisait remonter à la surface le refoulé de la lettre, sous forme menaçante ou persécutoire, et je pressentais un expéditeur de lettres anonymes à l’origine de sa décompensation. C’est dire qu’avant l’élaboration approfondie, le récit s’était introduit en moi sous forme de visions superposées, sans articulations précises les unes avec les autres. Et pendant des années je suis demeuré avec cette histoire embryonnaire, alors que quelque chose me retenait toujours de commencer l’écriture du texte, tant je redoutais l’univers mortifère dans lequel j’allais devoir m’immerger, comme d’ailleurs le style austère, dépouillé qui me semblait impératif (dès lors qu’un document historique était au cœur du projet de livre, document versé dans le patrimoine des hommes et par là intouchable). Mon habituelle hésitation faisait le reste : tout roman en devenir est un champ de questions obsédantes, souvent inutiles. Longtemps j’ai voulu contourner le document historique en inventant un document de même nature, comme il y en a eu sans doute des milliers, méthodiquement détruits par les administrations nazies, ceci en m’appuyant à l’époque sur les archives du KGB qui venaient d’alimenter après la chute du mur de Berlin l’historiographie des chambres à gaz. Mais au-delà de la difficulté d’inventer un tel document (je ne maîtrise pas l’allemand) je prenais alors le risque d’enlever au texte cet ancrage réel qui en sensibilisait profondément la lecture. Finalement j’ai donc tranché en faveur de la lettre véritable, avec sa prose glaçante et l’incroyable patronyme de son signataire, Jüst, entrouvrant comme diaboliquement tout le champ de l’analogie.
Car le livre se verra habité comme un mauvais rêve par le fatum de l’homonymie, de l’homophonie, de la ressemblance, Mathias Jüst a le même nom que l’expéditeur de la lettre, Rose résonne en français comme Kraus, lequel écrit : « l’original dont les imitateurs sont meilleurs n’en est pas un », et quelques éléments laissent à penser que Jüst ressemble à Neuman, son persécuteur, sans parler de la paire que forment sans le savoir Lucy et Lynn, femme et maîtresse de Mathias Jüst.
Dix ans se sont donc passés entre cette irruption dans ma vie du projet du livre et ce moment où je me suis mis à l’écrire en commençant par ces mots : « Cette histoire est maudite, il faut que je m’en délivre.» Etrangement cette phrase fut la seule que l’éditeur J.M. Roberts m’a demandé d’enlever et je pense qu’il a eu raison : il y avait trop d’emphase dans l’attaque, même si elle révélait combien le moment de la mise à l’écriture marquait pour moi une espèce de délivrance après un aussi long temps de gestation. Choses maudites, choses mal dites, choses marquées par un mal dire, une malédiction : était pourtant posé d’emblée ce dévoiement de la langue dont le récit allait tenter d’être le révélateur.
Curieusement et malgré mes inquiétudes, le mouvement de l’écriture s’est déroulé sans entrave, comme dans une chute retenue, avec un développement naturel de la narration, d’abord resserrée autour du mystère de Mathias Jüst puis basculant après la lecture de la lettre technique vers une menace plus sourde, plus diffuse qui enveloppant peu à peu le narrateur, se déplaçait insidieusement vers l’angle mort du livre, soit cet espace indécis où c’est le lecteur lui-même qui peut se sentir troublé, ébranlé, au point de s’apercevoir qu’il a glissé vers une autre lecture que celle du thriller d’entreprise qu’il avait cru entamer, et finir par douter de cette première lecture en se demandant s’il n’y avait pas déjà au commencement du récit quelques signes augurant de la bascule de celui-ci, des mots qu’il aurait lu sans cette ombre portée, dont il n’aurait pas perçu certaines acceptions cachées, comme si l’autre texte existait déjà sous le premier texte, désaccordant peu à peu celui-ci, y introduisant un autrement dit, un mal dit, une malédiction.
Une connaissance même fruste de l’Histoire nous enseigne que dans les temps de barbarie c’est d’abord le langage qui tue, c’est le langage qui ôte à l’autre que l’on veut tuer, toute existence humaine. D’ordinaire ces mots par lesquels les hommes disqualifient leurs ennemis mortels et au fond leurs semblables, tiennent de l’insulte caractérisée : il est un chien, un rat, une hyène, un cafard, une vermine, un puant, un jaune, un Tchetnik, un Oustachi… A ce dispositif de négation de l’autre par l’insulte, la machine génocidaire nazie a ajouté une amélioration terrible lorsque fut mise en place la Solution Finale : l’autre alors n’est plus, il n’existe plus, il n’est plus doté du moindre mot qui le définit. « Depuis décembre 1941, quatre vingt dix sept mille ont été traités (verabeitert) de façon exemplaire avec trois voitures dont le fonctionnement n’a révélé aucun défaut. » (Qu. H., Stock, 62) Ainsi commence la lettre technique, mais de quoi, de qui, de quatre vingt dix-sept mille quoi parle-t-elle ? Plus tard dans la lettre et parce qu’il faut bien au verbe de la phrase un sujet ou un complément d’objet, l’autre est défini techniquement en référence à l’objet central de la lettre, soit le camion Saurer dont il s’agit d’améliorer l’efficacité. On parlera dés lors de chargement (Ladüng) ou marchandise chargée (Ladegut) sans trop se soucier d’ailleurs de l’étrangeté qu’il y a à écrire dans la langue de Goethe un barbarisme comme « …le chargement a tendance à se mobiliser vers la porte arrière. » (Id., 64) Ainsi l’autre est-il alors effacé pour ce qu’il est : un homme, une femme, un enfant, mais reconnu pour la seule opération qu’il nécessite, ici une élimination physique si possible propre et rapide. Et pour qualifier le tout il peut être opportun que la réduction à la seule technicité de l’opération se teinte d’une dose de litote (procédé de style visant à faire entendre le plus en disant le moins): traitement spécial, solution finale de la question, Endlösung der Frage…
Loin du cynisme d’un tel traitement de la langue et donc insidieusement de la pensée, on est saisi aujourd’hui par l’extraordinaire développement d’un appareil discursif strictement technique, délogeant peu à peu l’humain de sa place centrale. La logique économique fait foi et loi. Par un renversement lent et progressif des perspectives, le travail qui auparavant était au service de l’homme, de son insertion dans la communauté, devient une valeur qui d’un certain point de vue n’a plus pour fonction que de nourrir la seule logique d’expansion de l’entreprise et de production de bénéfices. Et l’analogie avec la période noire de notre histoire est encore plus troublante lorsque l’on glisse de l’élimination des Juifs ou des Tsiganes vers celle des handicapés, gazés par les mêmes procédés, dans le cadre du programme Tiergarten 4 :
« -tout-élément-impropre-au-travail-sera-traité-en-conséquence-au-vu-des-seuls-critères-objectifs-comme-on-traite-un-membre-malade-ou-gangreneux-
-le-tri-s’effectuera-selon-la-planification-décrite-dans-les-cas-douteux-on-se-reportera-utilement-au-questionnaire-du-Reichsarbeitsgemeinschaft-Heil-und-Pflegeanstalten-
-le-programme-Tiergarten-4-tiendra-compte-de-la-capacité-au-travail-machinal-on-entend-par-là-l’aptitude-à-répéter-le-geste-efficace-sans-perte-de-performance-
-à-Grafeneck-neuf-mille-huit-cent-trente-neuf-ont-été-traités-à-Sonnenstein-cinq-mille-neuf-cent-quarante-trois-à-Bemburg-huit-mille-six-cent-un-et-à-Hadamar-dix-mille-soixante-douze » (Id. , p. 87,88)
Ce texte sans ponctuation mais où chaque mot est séparé par un tiret, est extrait comme par réduction alchimique du second envoi (cette fois au narrateur) de l’expéditeur anonyme. Dans sa forme initiale il était mêlé à des fragments textuels repiqués d’un manuel de psychologie du travail : obsession ici encore du texte maudit contaminant le texte actuel, de même qu’il produisait des blancs, des absences signifiantes dans le brouillon des rapports de Mathias Jüst, corrigés par sa secrétaire. Présence des vocables allemands dans le texte français, traitements typographiques différenciés : tout fait ici matière au texte comme s’il fallait signifier que ce qui est soumis à ébranlement dans ce petit livre c’est la langue elle-même, la langue et quoiqu’on le veuille ce socle à la pensée que la langue finit par fonder. « C’est plus tard, dira Neuman, l’expéditeur anonyme, en parlant de Jüst, c’est plus tard que j’ai pris la mesure de son aveuglement, mais aussi d’un autre aveuglement bien pire, bien plus étendu, quelque chose comme un dérèglement de la langue qu’absorbaient ces êtres à la folie gelée comme l’était Mathias Jüst. » (Id., p.92)
Ecrite en quatre mois, à l’hiver 1997-1998, la première écriture de la Question humaine, a plutôt été fluide, sans retour en arrière, dans un processus où plus que dans un autre roman je savais où j’allais, même si je ne savais jamais comment y aller. Là était peut-être la difficulté essentielle de ce petit livre, doté à l’avance d’une telle charge de sens qu’il risquait d’être écrit – et reçu – comme un roman à thèse plutôt que comme une allégorie porteuse de questions. A ce titre le dialogue avec Neuman était à haut risque, Neuman nous parle mais peut-être comme l’évoque Blanchot à propos de la parole prophétique : sa phrase est trop imagée pour être parfaitement audible, et Neuman disparaît derrière elle dans une ultime interrogation. Par celle-ci comme par toutes celles qui parsèment le récit, j’entendais mettre le lecteur en alerte, afin qu’une fois le livre refermé il demeure troublé. L’énorme, et parfois encombrante, réaction qu’il a suscité, m’invite à penser que nous sommes loin d’en avoir fini avec les questions qu’il pose.
Extrait de Les voix et les ombres, Chaire de poétique 2007, Université de Louvain-la-neuve Editions Lansman, septembre 2007