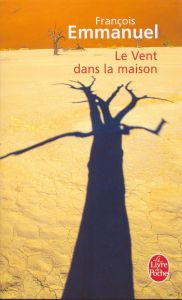

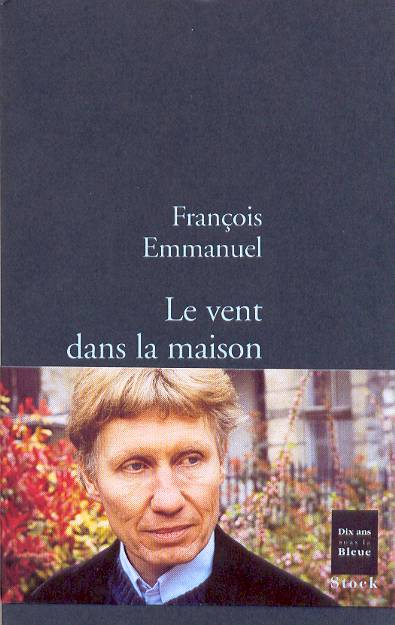
Édition: Éditions Stock, septembre 2004
Le livre de poche N°30724
Prix Palette (Nantes) 2004.
« La neige avait cessé de tomber, c’était un encerclement blanc qui infiltrait de sa clarté vive le chaos de la maison. Tu t’étais habillée, toute la matinée tu t’étais mise à ranger avec moi, compulsivement, comme s’il fallait à tout prix effacer les traces du désordre, refermer les tiroirs, retrouver la juste place des choses. Lire la suite
Ton regard semblait apaisé mais mort, parfois tu t’interrompais dans ta tâche, marmonnant tout bas quelque chose, et je sentais comme était fragile ta détermination. En début d’après-midi nous avons pris la voiture par les chemins enneigés, tu n’as pas dit un mot de toute la route, tes yeux éblouis par la blancheur, le nappé des paysages puis la lente arrivée parmi les encaissements de la ville, la neige qui devenait sale et bourbeuse, tandis que nous glissions lentement le longs des quais, des entrepôts numérotés et des empilements de conteneurs. Sara nous attendait au pied de son immeuble, elle a voulu se pencher vers toi pour t’embrasser mais tu n’as pas répondu à son salut, tu es montée la première dans l’escalier, seule et raide, aimantée par la salle de danse du troisième étage. Là, dans ce vaste loft au plancher sonore et aux fenêtres ogivales dont les traverses disparaissaient dans la clarté trop blanche, tu es restée longtemps à errer du regard comme si ce lieu ne ressemblait à rien, n’était d’aucune mémoire, puis tu t’es engouffrée dans le petit vestiaire pour ôter tes bottes, ton manteau et réapparaître en collant et boléro noir. Sara t’a prise par la main et vous avez marché de long en large pendant un temps qui m’a semblé très long, puis elle t’a laissée seule et tu as continué à évoluer dans l’espace, d’un pas automatique, hésitant parfois, changeant soudain de direction comme si tu rencontrais un mur invisible, la musique alors a envahi la salle, un rythme alternativement clair et sombre sur lequel une voix de femme poursuivait sans fin son inflexion chantée, à l’évidence tu as dû reconnaître cette musique car tu t’es immobilisée, saisie par surprise, tu t’es retournée vers la porte du vestiaire, il s’est passé quelques secondes puis tu es tombée d’un coup, ta tête contre le plancher. Sara n’a pas eu un geste, elle est demeurée sans réaction face à ton corps inanimé tandis que la voix enflait dans l’espace désert et que j’étais moi aussi incapable du moindre mouvement. Et quand après de longues secondes j’ai vu trembler tes jambes, j’ai cru à une crise avec bave sur les lèvres et rictus au visage, mais c’était tout autre chose : le réveil, la réminiscence, d’une ancienne figure, dépliant ton corps autour de la faille de ton ventre, dans une ouverture lente, reptatoire, difficile, comme si tu t’arrachais à la boue du monde, arrachais ton corps de l’attraction des choses basses, terreuses, tandis que l’on voyait luire la sueur sur ton visage aux yeux presque clos, Sara s’est approchée après un temps, elle a paru mimer ton mouvement, lui donner une réplique jumelle, animale, pour peu à peu l’éteindre, t’invitant à te détendre comme elle, relâcher la tension, demeurer couchée à distance et laisser ta respiration peu à peu s’approfondir. La musique s’est enfin tue, tu regardais Sara, je t’entendais répéter « Sail, Sail » et Sara chuchoter quelque chose que je ne pouvais pas comprendre. Assez soudainement tu t’es relevée, tu t’es dirigée vers l’encoignure du vestiaire et là, prise d’une impulsion soudaine, tu as dressé ton bras comme pour le projeter vers le mur quand la voix de Sara a claqué, impérative : c’est très bien, Alice, rhabille-toi maintenant, c’est très bien. Ton geste s’est arrêté net. Tu es restée un temps à vaciller dans l’espace puis tu es allée te rhabiller en silence. Sara avait le regard dur, elle a simplement dit qu’elle t’attendait le lendemain. Dans la voiture je te sentais en proie à une nervosité mal contenue, tu fixais les lumières de la route, tu pleurais par à-coups.
Trois jours de suite nous sommes retournés à l’atelier. De ces tentatives, cette succession tâtonnante de figures dansées, je n’ai pu voir apparaître que lentement le motif ou l’image. Tu marches, tu t’ouvres, tu enjambes l’air, tu tournoies et te cognes, tu chancelles au bord de tomber, tu es un haillon informe, un pantin qui se démembre, rien, plus rien ne te tient ou ne te dresse que de vagues tressautements, tu roules en tombant, tu te relèves, tu fais quelques pas, tu te laisses à nouveau tomber, à plat, tu te relèves, tu es une bête poursuivie par une meute, un oiseau que ses ailes encombrent, un spectre qui se désarticule, mais dans cette interminable fin de course je crois voir apparaître une autre scène, comme si tu retrouvais à tâtons dans la mémoire du corps la part femme d’un dialogue dont manque aujourd’hui le partenaire, et je le vois, Sail Hanangeïlé, t’attirer par son absence, te ceindre, te soulever, à l’endroit où aujourd’hui tes jambes ne te portent plus, tu as perdu ton axe, ton amour, tu tombes, indéfiniment tu tombes. Et Sara finit par s’approcher sur l’espace de danse, elle attend accroupie d’entrer dans ton cercle, puis vient présenter son corps là où existait le sien, faire naître une hésitation de lui à elle, chercher le contact avec la fatiguée de toi, la fourbue, l’exténuée de toi. Allongée sur le plancher Sara vient consoler la place entre vous vacante, caresser l’air avec sa main tandis que peu à peu tu lui cèdes, vous êtes des petites filles qui jouent au sol et font des lianes, des conspirations. Plus tard, alors qu’elle t’a laissée de nouveau seule, tu as ce geste de toucher ton ventre, comme pour t’essuyer le bout des doigts sales, tu appuies avec ta paume sur ton ventre, tu ouvres obscènement les jambes, tu te racles le haut du pubis et c’est pire que chez les Sengui, c’est insupportable à regarder, parce qu’une autre image s’impose, celle où tu accouches d’un résidu d’enfant, tu mets la mort au monde, tu inscris dans ta chair de ta main rauque, râpeuse, machinale ce qu’il te faudra désormais lire pour l’éternité : la mort enfant. Sara rôde autour de ce cérémonial, elle attend que cela se passe, puis doucement elle vient chercher le contact, t’imposer mimétiquement le calme, elle te parle à voix basse, elle dit que c’était très beau, très simple, mais que maintenant il va falloir cesser, se détacher, partir, elle dit que ce qui est posé est posé, rien n’est perdu, elle aimerait juste te voir mieux détacher ton geste la prochaine fois. Et tu la regardes effarée, tu te lèves parce qu’elle te prend par la main, tu te rhabilles comme une automate. Dans la voiture tu ne dis rien, à la maison tu te couches, toutes tes pensées semblent requises par le seul moment de la danse, là-bas sur le plancher blond, après l’allée des conteneurs et des grues. Ta folie n’est plus apparente, tu fais ce qu’il faut faire, tu hoches la tête, oui, non, quand je t’interroge, tu dors beaucoup, il me semble que tes forces déclinent. Le troisième jour tu grelottes en arrivant à l’atelier mais dès l’instant où tu es sur scène l’impulsion te reprend de courir, tomber, te relever, propulser ton corps comme une torche de chiffon contre le plancher qui sonne, puis ce rituel méthodique de l’arrachement, l’écartèlement, le tissu de ton boléro que tu déchires avec les ongles, au point que Sara doit te crier de cesser, te ceinturer par l’arrière, vaciller avec toi, te retenir, te contenir, te lâcher et alors, d’un coup : la fin de tout, tu t’es laissée tomber, tu t’es recroquevillée à même le sol, tu ne te relèves plus. Ta peau est brûlante, il faut t’envelopper d’une couverture. Je te porte jusqu’à la voiture et Sara est montée à l’arrière. Nous te couchons dans le lit haletante de fièvre. Tes yeux sont clos, tes lèvres exsangues, la danse a pris ce qu’il te restait de vie, tu détournes la tête lorsque je cherche à te faire boire, ta nuque s’affale, c’est fini. »
P. 168-174